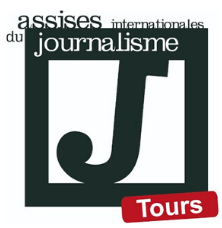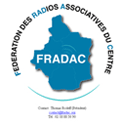[CITERADIO] Chronique littéraire – Bénédicte Flye Sainte Marie – “Le moins Qu’on Puisse Lire” – 1er juillet 2025

Bénédicte Flye Sainte Marie, rédactrice en chef et directrice de la publication du site Le Moins Qu’on Puisse Lire, nous propose une nouvelle sélection de livres à découvrir.
Bonjour Bénédicte, vous êtes de nouveau sur les ondes de CITERADIO pour nous présenter les choix du mois de votre média littéraire Le Moins Qu’on Puisse Lire. Aujourd’hui, vous souhaitez d’abord évoquer la sensation littéraire du moment…
Oui, impossible de commencer cette chronique sans mettre en lumière Mon vrai nom est Élisabeth, d’Adèle Yon qui est le coup de cœur, pour ne pas dire le coup de foudre absolu, de Marine Gradel, qui vient de rejoindre Le Moins Qu’on Puisse Lire, une rédaction qui ne cesse de s’agrandir au fil des semaines et des mois, pour notre plus grand bonheur. Pour ceux qui suivent le football et l’Équipe de France, Adèle Yon, c’est un peu la Désiré Doué du monde du livre. Il y a encore un an, personne ne la connaissait. Aujourd’hui, tout le monde n’a que son nom à la bouche. Lui marque des buts, elle, les esprits. Mais si cette jeune autrice au parcours surprenant, puisqu’elle est à la fois normalienne, chercheuse en études cinématographiques et cheffe cuisinière, fait autant parler d’elle, c’est qu’il y a de très bonnes raisons. Elle nous propose en effet avec ce roman Mon vrai nom est Élisabeth un objet littéraire assez exceptionnel, autant dans le genre ou plutôt le mélange des genres pour lequel elle opte, entre l’essai, l’enquête, l’autofiction, le journal de voyage que dans son style et son propos. Adèle Yon y raconte l’histoire de son arrière-grand-mère, Élisabeth dite Betsy, une aïeule qui a longtemps été dans la famille d’Adèle une sorte de fantôme terrifiant puisqu’elle était atteinte de schizophrénie et qu’elle a été internée sous contrainte pendant pas moins de 17 ans. Mais alors qu’Adèle investigue sur cette ancêtre, au moment où elle-même traverse une rupture très douloureuse et où elle redoute de basculer elle aussi dans cette démence qui serait héréditaire, elle réalise que l’histoire réelle d’Élisabeth n’est pas du tout celle qu’on lui a racontée ou plutôt qu’on s’est bien gardé de lui raconter. Si Élisabeth-Betsy a eu droit à des traitements brutaux, pour ne pas dire inhumains, comme des cures de Sakel, un produit qui causait par le biais d’injections des comas hyperglycémiques, de nombreuses séances d’électrochocs, et encore pire, à une lobotomie, une intervention chirurgicale barbare qui consiste à sectionner les fibres nerveuses du lobe frontale dans le cerveau, ce n’est pas parce que son état de santé le nécessitait. C’est parce que Betsy était une femme trop libre, trop brillante, trop extravagante pour son milieu très bourgeois et son époque. Rigide, ultra-conservateur, André, son mari, était son exact opposé. Et faute de réussir à remettre dans le rang cette femme pas assez lisse à ses yeux, cet époux, qui en était venu à la considérer comme “une gêne”, comme l’explique Adèle Yon, va donc la faire admettre dans un asile. Là, le corps médical va donc la martyriser pendant plus d’une décennie et demie et lui retirer toute sa joie, toute sa flamme, toute sa vie. Au-delà du simple exemple d’Élisabeth, Adèle a découvert et nous explique dans cet ouvrage que Betsy n’est qu’une victime parmi d’innombrables femmes suppliciées par la psychiatrie, parce qu’elles étaient insuffisamment dociles et conformes aux attentes de la société. C’est un récit incroyablement fort, publié par les Éditions du sous-sol qui a déjà reçu plusieurs prix dont le Prix Essai France Télévisions, le Prix littéraire du Barreau de Marseille et le Prix Régine Deforges du Premier Roman 2025 (dont on va d’ailleurs interviewer très bientôt la fondatrice Camille Deforges) et qui donc ne devrait pas s’arrêter là…
Bénédicte, vous vouliez ensuite nous parler d’une autre femme qui sortait des cadres et des carcans et du livre qui lui est consacré étant Les vies rêvées de la baronne d’Oettingen…
Absolument, dans ce roman que j’ai lu dans sa version poche parue aux éditions Folio il y a quelques semaines, Thomas Snégaroff, que vous connaissez peut-être mieux dans le cadre de ses activités audiovisuelles et dans son rôle de journaliste et présentateur de C Politique sur France 5 et du Grand Face-à-face de France Inter, s’intéresse à une figure qui a beaucoup compté pour son arrière-grand-père, l’imprimeur Dimitri Snégaroff, à savoir la baronne d’Oettingen. Née en Ukraine à la fin du XIXème siècle dans un château sinistre, Hélène, fille d’une comtesse russe a saisi très jeune l’opportunité que lui offrait son mariage avec le baron d’Oettingen pour s’échapper de ce lieu aux allures de prison et s’offrir l’existence dont elle rêvait. Si l’union avec l’aristocrate en question a été très éphémère, elle a gardé son titre et s’en est servie comme d’un passeport pour entrer dans la société parisienne de La Belle Époque et pour goûter à toute son effervescence. L’appartement dans lequel elle aménagera pendant la Première Guerre Mondiale, précisément au 229 boulevard Raspail, sera l’épicentre de tout ce qui va l’agiter pendant des décennies, de ses explorations artistiques et littéraires puisqu’elle sera écrivaine, poète, peintre et bien d’autres choses encore, de ses amitiés avec d’illustres personnalités, parmi lesquelles Guillaume Apollinaire, Fernand Léger, Pablo Picasso, et de ses amours tumultueuses. Fuyant l’attachement, la baronne d’Oettingen abandonnera toujours les hommes qui l’aiment de peur de souffrir et les regrettera ensuite, une fois que leur cœur naviguera ailleurs. Bref, je vous conseille vraiment cette biographie car la plume de Thomas Snégaroff est assez remarquable de fluidité, de beauté et d’érudition.
On change ensuite de registre et aussi de touche sur la télécommande pour aborder Les vivants, le roman d’Ambre Chalumeau, qui est autrice mais également chroniqueuse dans l’émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC…
Effectivement, parce que c’est un roman dont Anne-Sophie Campagne, qui vient elle aussi d’intégrer notre média Le Moins Qu’on Puisse Lire, a beaucoup aimé le style et la sensibilité. Ambre Chalumeau s’y empare de la trajectoire de 3 ados de 17 ans nommés Cora, Diane et Simon. Inséparables, beaux, doués et dynamiques, ils semblaient avoir le monde à leurs pieds, un avenir doré et tous les possibles à embrasser. Mais un jour, Simon va être terrassé par un virus foudroyant dont on ne sait pas vraiment déterminer l’origine et il va plonger dans le coma. Cela va complétement rebattre les cartes. Pour Cora et Diane, étranglées par la maladie de Simon, qui les prive à la fois de leur complicité et de leur insouciance, il va falloir trouver, malgré ce drame et malgré cette présence qui ressemble à une absence, le moyen d’avancer et de se construire en tant qu’adultes. Elles vont s’éloigner, trouver des solutions qui ne sont pas forcément les meilleures, comme de se noyer dans le travail, et parfois voir rejaillir ce traumatisme là où elles ne s’y attendaient pas. Pour Anne-Sophie, notre chroniqueuse, c’est un livre uppercut, mais un coup de poing qui est salvateur puisqu’il nous permet, je la cite, de “savourer le simple bonheur d’être vivant“. Et c’est publié aux éditions Stock.
On termine la sélection du mois de Le Moins Qu’on Puisse lire avec Le Ciel de Tokyo, d’Émilie Desvaux, qui est lui aussi empreint de mélancolie et parfois d’espoir…
Oui, le dernier ouvrage que je vous présente et non des moindres puisqu’il vient de recevoir le Prix Littéraire des Sciences Po 2025 est donc signé Emilie Desvaux et a été lu avec grand intérêt et enthousiasme par Marceline Bodier, chroniqueuse qui a rallié aussi depuis peu de notre rédaction ; Marceline qui fait d’ailleurs partie du comité de lecture qui décerne cette récompense.
Dans ce roman, l’autrice nous immerge dans le quotidien d’une pension japonaise un peu miteuse du quartier d’Asakusa, dans la capitale nippone, un endroit où se croise un aréopage de personnages, des jeunes gens en rupture avec leurs familles qui sont comme étouffés par la société dans laquelle ils vivent et qui sont en pleine recherche existentielle. Pour Marceline, c’est une sorte de mélange réussi entre L’auberge espagnole ; si l’on considère le coté collégial de l’intrigue, et Lost in translation, pour la quête de sens. Et c’est aussi un texte qui est magnifiquement écrit et très symbolique de notre temps, de la difficulté qu’il y a de trouver sa place dans un monde qui va trop vite et ne tient plus à rien. C’est paru aux éditions Rivages et vous retrouverez évidemment sa chronique sur Le Moins Qu’on Puisse lire, www.lmqpl.com.
Voilà, j’en ai fini avec les choix du mois de Le Moins Qu’on Puisse Lire. Je me réjouis de vous retrouver bientôt sur l’antenne de CITERADIO, Guillaume, et je n’oublie pas de vous souhaiter un très joyeux anniversaire !
Merci beaucoup chère Bénédicte pour cette belle sélection et à très bientôt !